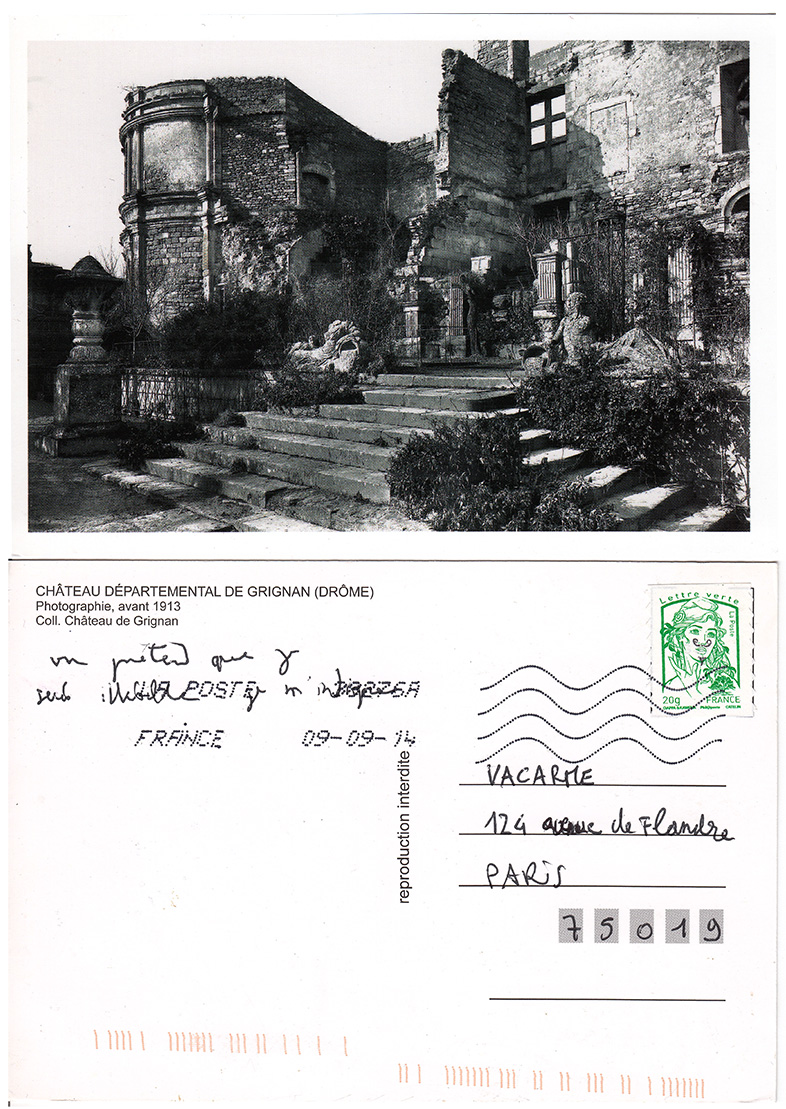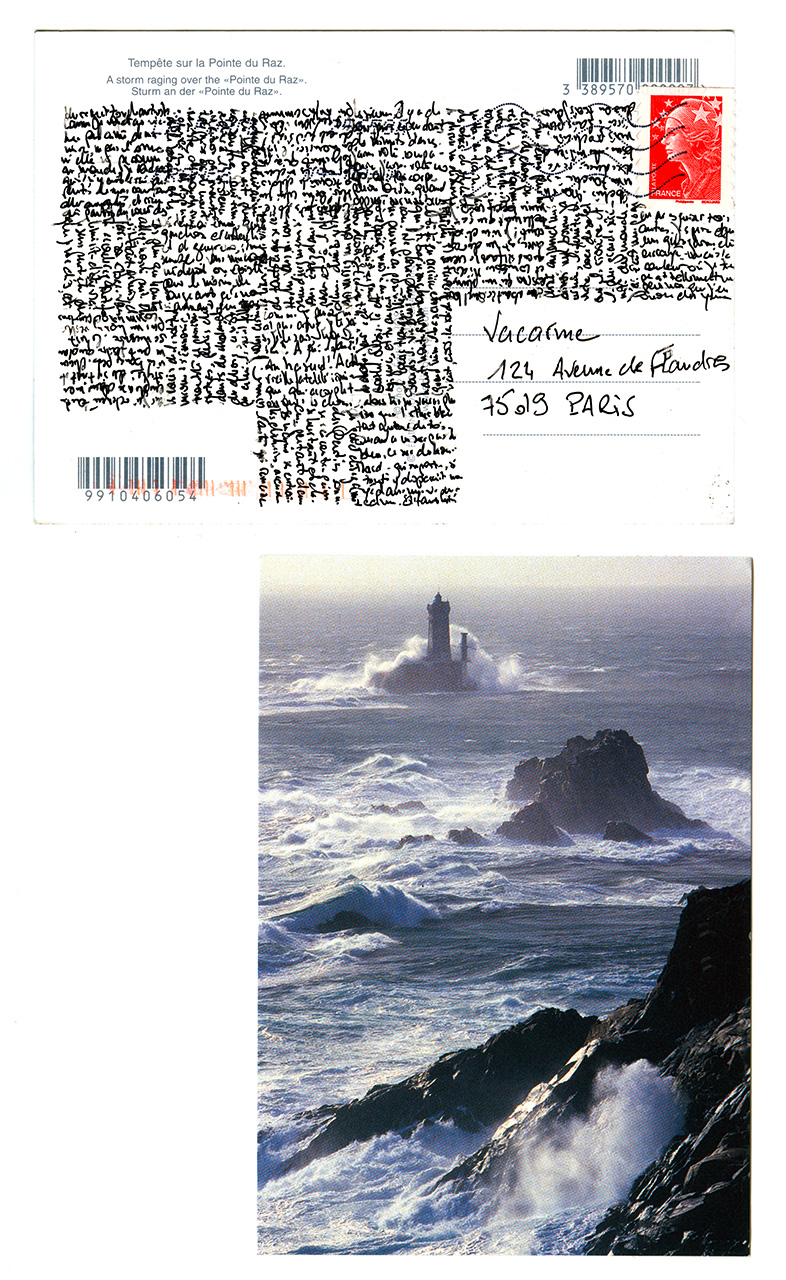Des joies mauvaises et bonnes de ne pas être compris
par Pierre Zaoui
Tous les devenirs indéchiffrables ne se valent pas. Certains, par ruse, par nécessité, par prudence, protègent mais divisent, d’autres, jeux de cache-cache élaborés, vous piègent, esseulé à force d’être secret. Échappant à la mélancolie de l’incompris et à la politique aristocratique du masque, plus qu’un moyen, il y aurait un devenir ininterpretable et joyeux : ultime et audacieuse hypothèse, à saisir.
« Oh ! comme les voies de Dieu sont incompréhensibles, et comme un être incompréhensible est aimable ! »
Sade, La Nouvelle Justine
Le chiffre fut d’abord une affaire d’État et de militaires : parvenir à se rendre indéchiffrable à ses ennemis tout en étant compris par ses alliés ou ses soldats. Par contrecoup, il fut ensuite ou en même temps l’affaire de tous ceux qui durent se cacher de l’État et des cercles du pouvoir, pour s’en protéger : tantôt ceux qui ne pouvaient penser et écrire qu’au risque de leur persécution, suivant l’hypothèse de Léo Strauss ; tantôt, symétriquement, ceux qui voyaient dans leurs découvertes un danger non pour eux-mêmes, mais pour les autres, trop ignorants ou trop enfants (toute la tradition magique et ésotérique) ; tantôt encore ceux qui cherchaient à pénétrer l’État ou à s’en emparer ; tantôt au contraire ceux qui en faisaient partie et tenaient fermement à en exclure les autres. En dehors des guerres entre États, le chiffre fut donc d’abord affaire d’hérétiques, de thaumaturges, d’intrigants et de courtisans, ou, dans un monde plus moderne, de libres penseurs, de maboules, d’aristocrates et de bourgeois arrivistes. Dans les quatre cas, toutefois, qu’il s’agisse de pénétrer l’État (et plus généralement l’ordre commun), de le protéger ou de s’en protéger, devenir indéchiffrable, chercher à n’être pas compris, ne pouvait constituer ni une fin en soi, ni même une fin complète : seulement une protection et une restriction, c’est-à-dire un moyen, non une fin, et un moyen qui demeurait au service d’une fin contraire — parvenir à être compris, au moins de quelques-uns, au mieux présents, au pire à venir (les initiés de l’école ou de la secte, les happy few de Stendhal, les « philosophes de l’avenir » de Nietzsche).
Il est à parier que cela n’a guère changé aujourd’hui : on continue à chiffrer ses discours ou ses messages à toutes fins de diviser l’humanité en deux — amis appelés à comprendre et ennemis ou rivaux appelés à ne pas comprendre. Nulle joie apparente alors de l’indéchiffrable, seulement l’effet d’une nécessité, d’une prudence, d’une compassion (plus ou moins paternaliste), ou d’une ruse. Sinon celle, mauvaise, de la domination et de l’exclusion, ou celle, bien meilleure mais enfantine, des parties de cache-cache : aimer à se cacher sous un chiffre pour mieux être déchiffré, retrouvé, reconnu. Mais là encore, pas question que le jeu s’achève sur une incompréhension : quelle détresse pour le petit enfant jouant à cache-cache que de voir les autres abandonner la partie et le laisser seul dans sa cachette ; quelle détresse de même pour le dominant aux codes volontairement incompréhensibles que d’être tant incompris qu’il n’est même plus reconnu comme dominant, les pointes mêmes de son mépris, à force de subtilités tordues, devenant illisibles, ne blessant plus personne, à la manière d’un Charlus au milieu des Verdurin.
Et pourtant il existe d’autres cas, ou bien les mêmes, mais examinés depuis une autre perspective, dans lesquels devenir indéchiffrable apparaît soudain comme une source de joies autonomes. Ainsi lors des jeux de séduction, où l’essentiel de la charge érotique s’affaisse dès que s’estompent le trouble et la captation imprévue. Ainsi l’ennui mortel d’un trait d’humour expliqué. Ainsi, peut-être, de l’inexplicable joie que semble éprouver le Dieu d’Isaïe à se cacher. Ainsi encore de la joie anarchiste de demeurer à jamais incompris pour ne jamais être saisi. On pourrait multiplier les exemples : nos existences sont autant tissées de désirs d’être compris que de joies tenaces de demeurer incompris.
Vouloir tout comprendre, jusqu’au désir de n’être pas compris, voilà donc tout le programme.
Ce sont ces dernières que nous aimerions interroger en-dehors de toutes questions d’État et de prudence politique, ou bien seulement dans leurs marges. Autrement dit, oublier l’éternelle dialectique du masque et de la reconnaissance propre à la vie sociale, pour s’attacher à prendre à revers nos deux terreurs peut-être les plus communes : d’une part, la terreur de comprendre, parfaitement compréhensible vue la violence de certaines vérités ; d’autre part, la terreur mélancolique de demeurer incompris, en avançant que de telles terreurs nous privent peut-être d’autant de joies que de malheurs.
Vouloir tout comprendre, jusqu’au désir de n’être pas compris, voilà donc tout le programme. Le problème est qu’on ne saurait, par définition, saisir ces joies jusqu’au bout. Sont-elles bonnes ? Sont-elles mauvaises ? Naturelles ou contre-nature ? Précieuses ou dangereuses ? Essentielles ou fautes de mieux ? Et surtout : se renforcent-elles les unes les autres ou au contraire tendent-elles à s’annuler à trop les multiplier ? On ne peut pas savoir d’avance, et en un certain sens on ne pourra jamais le savoir. Mais on peut au moins s’amuser à en énumérer quelques-unes. Une sorte d’inventaire fantastique des joies de l’obscur.
La première joie, en tout cas la plus évidente, à devenir indéchiffrable, on y a déjà fait allusion, est de nature érotique. Elle ne provient sans doute pas du simple constat lucide que les autres s’enfuiraient à toutes jambes s’ils savaient ce qui nous fait courir pour de vrai, car si le constat n’est sans doute pas faux, il ne dénote que de l’angoisse sèche, pas de joies. Elle provient plutôt de deux choses. D’une part, de ce que le désir érotique n’est jamais aussi plaisant et intense que dans l’immédiateté pratique de son surgissement, et ce aussi bien pour l’autre (à un certain niveau, seuls le mystère, l’enveloppement de milliers de mondes inconnus, pour parler comme Proust, rendent séduisant) que pour soi (on ne sent la pleine effectivité de son désir que dans l’irréflexion). D’autre part, de ce que l’on ne vise que l’autre quand on aime pour de vrai, et que se sentir compris ne pourrait que ramener à soi et faire perdre de vue l’objet convoité. Dans les affaires d’amour et de désir sérieux, toutes les justifications et tous les « parce que » sont des éteignoirs.
Si l’on admet une telle étiologie, on doit toutefois reconnaître qu’il ne peut s’agir là d’une joie première, puisqu’elle en présuppose de fait deux autres beaucoup plus larges. D’abord on trouve la joie de toucher au réel, au sens lacanien, c’est-à-dire à quelque chose qui nous échappe radicalement et que la conscience ne saurait élaborer pleinement — n’être pas compris, c’est sentir en soi une consistance réelle, quelque chose que nul ne peut saisir en tant que tel, ni par des symboles ou des noms, ni par des images, et pourtant quelque chose qui insiste et résiste. Ensuite, et corollairement, on peut apercevoir l’étrange joie d’être indifférent à soi, de se dessaisir de tout souci de soi, de sortir de soi. La joie de n’être pas compris se comprend alors comme joie de ne pas être compris en premier lieu par soi-même, d’être « à soi-même le plus lointain » comme dit Nietzsche renversant Pindare, d’en finir pour de bon avec les états d’âme fatigués et fatigants de sa baudruche intime qu’on nomme moi. Car dans cette perspective, toute incompréhension de la part de l’autre résonne comme un espoir et un rappel — qu’il n’y a peut-être effectivement rien à comprendre à soi-même, et qu’on doit passer à autre chose. Or ces deux sortes de joie vont effectivement bien au delà du désir érotique stricto sensu. On les retrouve même dans l’expérience la plus commune : on dit à l’autre « je ne te comprends pas », et on le voit sourire d’un sourire étrangement non scélérat, tout innocent — d’aucuns appellent cela l’adolescence, mais elle peut durer toute la vie.
Il semble ainsi que l’on comprenne un peu mieux tout ce qu’il peut y avoir de bon à se sentir indéchiffrable. Mais le problème se corse dès qu’on s’aperçoit qu’il existe d’autres sortes de joie, radicalement opposées à celles-ci, sans mystère, sans décentrement, et pourtant puisant à la même source. Ce sont justement toutes les joies par lesquelles on parvient à se retrouver soi-même grâce à l’incompréhension publique, qui est à maints égards la condition sine qua non de toute solitude précieuse. On aime alors n’être pas compris pour n’être justement pas compris, pas pris par l’autre, pas prisonnier de ses raisonnements ni de ses rêves. Il n’y a pas d’esprit libre qui puisse vouloir être entièrement compris tant il est certain qu’à un niveau ou à un autre toute compréhension est une chaîne, voire un esclavage qui nous fige dans ce que l’on est au lieu de nous ouvrir vers de nouveaux devenirs et de nouvelles expériences.
On aime alors n’être pas compris pour n’être justement pas compris, pas pris par l’autre, pas prisonnier de ses raisonnements ni de ses rêves.
Cette sorte de joie est toutefois plus compliquée qu’il n’y paraît au premier abord tant elle apparaît très vite, en seconde analyse, tissée de joies elles-mêmes disparates et peu articulables. À côté de la simple joie de la solitude et de la liberté, elle contient en effet la joie, qui relève peut-être davantage du soulagement que de la joie, de voir l’autre incapable de sonder notre cœur et nos reins là même où ils paraissent les plus simples et les plus transparents. C’est en effet un soulagement heureux de mesurer combien les autres en général ne nous comprennent pas, non parce que nous serions incompréhensibles, mais parce qu’ils ne pensent à peu près jamais à nous, seulement à eux. On réapprend ainsi à voir les autres en trois dimensions, à prendre en compte leur propre point de vue, et cela calme notre paranoïa instinctive, freine nos délires d’interprétation — plus besoin de s’ingénier à se demander ce que les autres pensent de soi dès qu’on a compris qu’ils n’en pensent à peu près rien (trois mots, deux images, oui, presque rien). Tout occupé à soi, l’autre est au fond un chouette compagnon de solitude — joie d’être dépris, lâché : « pars, pars ». Mais à côté d’elle, on trouve généralement encore une autre joie, d’une tout autre nature, celle d’être non dépris, mais repris, c’est-à-dire braconné, déplacé, réinventé. Il n’y a que les philosophes dogmatiques, les écrivains médiocres et les amants jaloux pour détester le contresens et le malentendu. A l’opposé, c’est le propre des plus grandes âmes que de souhaiter une telle réinvention, de n’avoir que faire des Oui de l’âne et des rengaines du bouffon, pourrait-on dire en paraphrasant le Zarathoustra de Nietzsche : ne viser qu’au nouveau, à des répétitions complexes, à des reprises qui enrichissent, reforment, déforment. En ce sens, toutefois, de telles joies ne sont plus tout à fait des joies d’être in-compris au sens propre, mais plutôt mé-pris, mal compris, ou compris à moitié. Ce sont les joies de l’inestimable quiproquo qui seul parfois, au bout de tout partage, peut rendre encore les hommes intéressants les uns aux autres.
Que l’on soit donc dépris, repris, « mé-pris » (au sens de méprise), que l’on nous lâche ou qu’on nous déplace, mais par pitié qu’on ne cherche pas trop à nous comprendre. Un tel mot d’ordre, certes, fleure bon encore un certain aristocratisme. Aristocratisme sans doute complexe puisqu’il comporte aussi bien la joie d’énoncer des vérités trop hautes pour le vulgaire que la joie de dire n’importe quoi, aussi bien la joie de s’élever que la joie de s’abaisser, aussi bien la joie du surhomme nietzschéen que celle de la loque beckettienne, mais aristocratisme tout de même : on trouvera toujours en lui, à un endroit ou à un autre, la noire joie de confondre les inférieurs et les médiocres. Mais il est intéressant de remarquer qu’il ne saurait pourtant faire système, devenir principe de hiérarchie politique ou de morgue sociale, à l’intérieur d’un authentique devenir indéchiffrable, tant il est appelé à un moment ou à un autre à se fracasser sur une joie absolument contraire, absolument égalitaire : celle du grand humour.
L’humour ordinaire, certes, peut toujours se teinter d’ironie, c’est-à-dire d’idées de derrière la tête ou de double discours, et produire ainsi d’odieux effets de complicité et de distinction, de classe et d’exclusion. Mais le vrai humour, le grand humour, celui qui chevauche le Non-sens à plein corps, est toujours une offrande à tous sans distinction et sans hiérarchie. Il peut certes décrire des princes, mais ces princes sont n’importe qui, des loosers, des bouseux, des minorités — petit bonhomme qui tombe dans la boue, reçoit sur la tête des poutres, des réverbères, des façades entières d’immeuble, des condamnations à mort et pourtant à chaque fois se relève intouché. L’humour est la grande joie égalitaire de l’incompréhensible, l’arpentage ouvert à tous de l’immense champ du dérisoire et de l’absurde qui constitue le fonds commun de nos existences, et peut-être leur sel le plus profond. Se réjouir en ce sens de n’être pas compris, c’est se réjouir d’une humanité à parts égales qui aurait fait exploser, joyeusement et en chœur, toute hiérarchie, tout esprit de sérieux, toute séparation entre bons et méchants ou entre forts et faibles.
Mais introduisez-y par malheur une once de compréhension, mettez une lichette de sens et de sérieux, une pincée de distinction, et tout est perdu — déjà on ne rit plus et des classes, elles très compréhensibles, réapparaissent. L’humour énonce ainsi en une fulgurance supra-politique qu’on ne se débarrassera jamais d’une société de classes tant qu’on croira encore aux classes logiques et linguistiques, tant que ne seront pas abolies les formes intelligibles de la compréhension mutuelle. En ce sens, toutefois, cette joie du non-sens, du partage démocratique de l’incompréhensible, ne saurait, elle aussi, durer éternellement. Au-delà d’un certain point, elle dépasse complètement toute simple joie de n’être pas compris pour toucher à l’inintelligibilité radicale de la vie et de la mort, c’est-à-dire pour toucher à la folie, à cette expérience où ce n’est plus soi mais la vie et le monde tout entiers qui passent du côté du non-sens et de l’insaisissable. A ce niveau, l’humour fait peur et doit nécessairement s’arrêter ou faire imploser le sujet qui l’emploie. Il dessine ainsi une sorte de chiasme avec les joies érotiques que nous avions initialement évoquées : dans celles-ci on aimerait bien que se poursuive le plus longtemps possible l’aura de mystère et de monstre incompréhensible qui nous entoure, mais on ne le peut pas, sauf à sombrer très vite dans les ruses les plus minables et les plus répétitives de la séduction désarticulée d’un désir vrai et singulier ; dans celui-là on l’aimerait tout autant mais on ne le doit pas, sauf à encourir les plus grands dangers.
***
On pourrait encore énumérer longuement, peut-être indéfiniment, les sortes de joies, obscures ou lumineuses, qu’emporte avec lui tout devenir indéchiffrable. Mais outre le ridicule qu’il y aurait à s’acharner à expliciter jusqu’au bout nos désirs d’être incompréhensible, les quelques exemples que l’on vient de traverser suffisent sans doute à mettre au jour la nature exacte de notre problème initial.
Se réjouir de n’être pas compris, c’est se réjouir d’une humanité à parts égales qui aurait fait exploser toute hiérarchie, toute séparation entre forts et faibles.
Depuis le départ, nous ne cherchons pas en effet à faire l’apologie des joies de l’incompréhension contre la quête de l’intelligibilité, mais simplement à soutenir qu’à côté des joies de la compréhension et des satisfactions de la libido sciendi peuvent exister d’autres joies, liées à l’indéchiffrable, par volonté ou par nature. Tout le problème tient alors au sens que l’on peut donner à cet « à côté de », à la manière dont joies de comprendre et joies de n’être pas compris peuvent se penser et se vivre ensemble. Car les secondes semblent remettre en cause radicalement les deux principes fondamentaux qui soutiennent l’existence des premières. D’une part, le principe de contradiction incontournable depuis Aristote et selon lequel on ne saurait produire deux énoncés contraires dans le même temps et sous le même rapport ; d’autre part, le principe de communicabilité du Bien, qui remonte à Platon, et plus clairement encore à saint Augustin, selon lequel il ne saurait exister de Bien qui ne soit pas communicabile, c’est-à-dire partageable et compréhensible en droit par tous — ce pourquoi l’esprit apprécierait spontanément les idées claires et non obscures ou mutilées, distinctes et non confuses, univoques et non équivoques, actuelles et non inactuelles, et donc transparentes plutôt que chiffrées. Or il est clair que les quelques joies que nous avons énumérées sont contradictoires : on se réjouit de n’être pas compris parce qu’à la fois on se perd et se retrouve soi-même dans cette obscurité, parce qu’on s’y retire en laissant briller l’autre, tout en le séduisant par son irréductible mystère, parce qu’on s’y confronte à tout le poids du réel autant qu’à la légèreté de l’humour qui fait exploser tout sens du réel, parce qu’on laisse parler ainsi autant ses pulsions aristocratiques que démocratiques, etc. Et il est tout aussi clair qu’elles ne sont pas communicables, sinon à froid, hors contexte et de manière toujours rétrospective — sans quoi ce serait vouloir être compris jusque dans son désir même de ne pas l’être, et ainsi retomber dans une dialectique ou une politique univoquement aristocratique du masque qui fait des désirs de n’être pas compris de simples moments ou détours d’un processus plus général de communication et de clarification, tel Nietzsche dans l’aphorisme 381 du Gai Savoir à propos de l’écriture. Il y soutient en effet ceci : « Quand on écrit c’est non seulement pour être compris, mais encore pour ne pas l’être ». Mais il le justifie par la raison au fond la plus convenue psychologiquement, et la plus antipathique politiquement : « Tout esprit un peu distingué, tout goût un peu relevé choisit ses auditeurs ; les choisissant il ferme la porte aux autres ». Au contraire, situer le problème au niveau des principes, c’est s’interdire d’avance ce genre de solutions de facilité : comment parvenir à chasser toute contradiction comme toute obscurité dans sa quête de vérités objectives tout en les admettant, et même en les choyant, dans ses joies intimes de n’être pas compris ?
La solution la plus simple, et en un sens la plus honnête, consisterait à assumer et affirmer radicalement cet écart infranchissable entre les deux types de joies, à faire de soi-même et de la vie tout entière non une solution ou une promesse mais un « problème », comme le soutient un autre Nietzsche, par exemple celui de la préface de ce même Gai savoir, ou à accepter de s’engager dans un processus schizophrénique sans retour, à la manière de Deleuze et Guattari dans L’Anti-Œdipe : oui, nous aimons et la contradiction et la non contradiction, et la transmission et l’incommunicabilité, et l’exposition et le secret, et les autres et nous-mêmes, et les meilleurs et n’importe qui, etc.
On aimerait pourtant avancer ici une hypothèse exactement inverse. Et s’il n’y avait là aucune contradiction ou problème à affirmer mais au contraire une unité ultime à sauver : ce qui nous rassemblerait tous, ce qui pourrait encore nous rassembler tous à l’avenir, ne serait rien d’autre qu’une radicale incompréhension partagée, qu’une inintelligibilité première de l’Être ? Et si donc se réjouir de n’être pas compris n’était en dernière analyse que l’ultime moyen d’être encore ensemble dans un monde sans fondement et sans principe (version métaphysique), ou dans des sociétés d’ignorance, c’est-à-dire dans des sociétés où même le plus savant des savants connaît moins de 1 % du savoir disponible (version empirique) ? Ultime extase d’une étrange a-théologie négative. Ultime jouissance de l’indéchiffrable, de l’ininterprétable. Béatitude de l’obscur.
Cela ne vous fait pas envie ? Mais êtes-vous bien sûr de nous comprendre ?