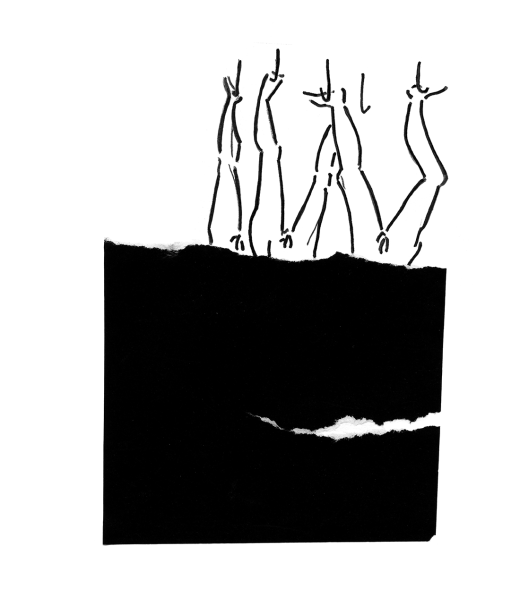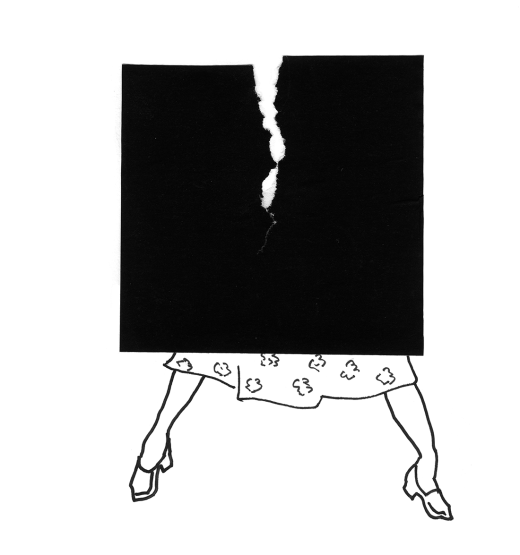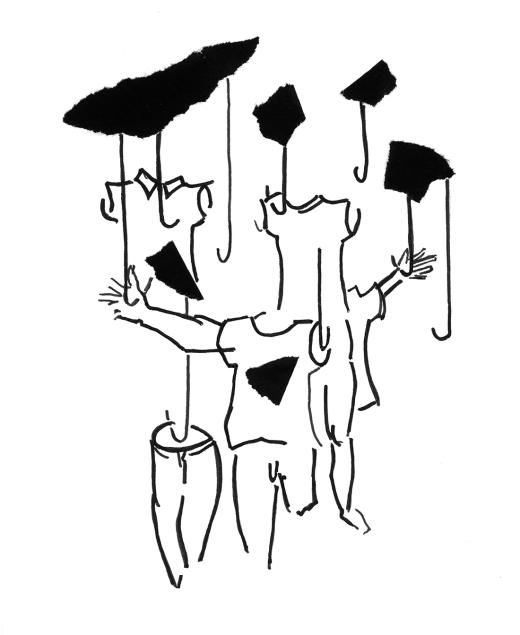sortir de l’effroi, prendre des forces
par Zoé Carle, Vincent Casanova, Valentin Chémery, Joseph Confavreux, Laurence Duchêne, Juliette Farjat, Aude Lalande, Sophie Rabau, Sophie Wahnich & Pierre Zaoui
Illustrations d'Antoine Perrot
« Mais qu’est-ce, mais qu’est-ce qu’on attend pour foutre le feu ». C’est Suprême NTM et c’était il y a vingt ans, en 1995. Jacques Chirac était élu Président de la République, Alain Juppé devenait Premier ministre et en décembre la rue était à nous. En 2005, il y eut le feu, et puis rien ou presque — pour Zyed et Bouna, le procès vient juste d’avoir lieu et le verdict est tombé le 18 mai 2015 : relaxe des policiers. « Les années passent, pourtant tout est toujours à sa place ». C’est Suprême NTM, et c’était il y a vingt ans aussi. En 2015, tout va-t-il péter ?
Ça va péter. On l’entend ou on le dit ; on ne sait plus si c’est une bonne ou une mauvaise nouvelle ; on ne sait plus quel « on » le dit, si c’est nous qui le disons ou alors eux. On dit « ça » parce qu’on ne sait pas bien si on veut en être ou pas. Mais le pire est peut-être que ça ne pète pas, qu’à chaque nouvelle agression sociale, économique, politique, on se dit que cette fois ça va venir, se lever, qu’à la violence de l’intolérable va répondre une autre violence. Et non. L’attente, la peur, l’inquiétude, l’espoir, l’annonce de la violence, sont l’autre nom de notre sidération devant ce que nous supportons de violence extérieure, sans jamais qu’un soulèvement n’advienne. Ça va péter, ça devrait péter, ça aurait dû péter. Que faire avec la violence d’insurrection, de réaction, de révolte qui est dans toutes les bouches et sur toutes les lèvres ? Continuer de la retenir parce qu’elle est un piège ? L’assumer et la réinventer ? Comment pouvons-nous être violents ? Avons-nous peur mais de quoi ? De la violence des corps ou d’une autre violence, qui symboliquement nous détruit ?
Rage Against The Machine
Une loi sur le renseignement réduit les libertés. Une autre loi met en pièce des acquis sociaux et passe en force, usant d’un article imaginé en pleine guerre d’indépendance algérienne. Les expulsions continuent bon train, un agent de l’État s’indigne qu’une manifestation soit organisée pour en contester la légitimité, des policiers brutalisent ordinairement des migrants. Après trois années de gouvernement d’un pouvoir incapable de conduire une réforme fiscale et de donner le droit de vote aux étrangers, mais comptable de la mort de Rémi Fraisse et d’être en guerre au Mali, en Centrafrique et quelque part depuis un porte-avion dans le golfe arabo-persique, la « sociale-démocratie » est nue. « Mais qu’est-ce, mais qu’est-ce qu’on attend pour foutre le feu ? ». Même les plus doux d’entre nous se le demandent — et vraiment ils sont très doux. Que faire si même eux en sont à se formuler un désir de violence ? Que faire ?
Commencer par se rappeler qu’aujourd’hui, les plus bruyants qui disent vouloir en découdre sont tous ceux qui vitupèrent contre le déclin de la nation, de l’école, des valeurs familiales, s’inquiètent de la libre circulation européenne, s’insurgent contre la « finance apatride » et « le système ». Pour les tenants de la décadence, quand on n’est pas violent, c’est qu’on se sent lâche. La décadence, c’est la décrue des forces. Notre terreur, c’est de voir plusieurs dizaines de milliers de personnes se réunissant pour éructer des slogans racistes lors d’un « Jour de colère ». Aujourd’hui, ceux qui manifestent leur désir de violence sont tous ceux qui appellent à se défendre de l’autre et prophétisent la guerre civile. Ils s’habillent en costume de résistant et déversent leurs mots immondes, tabassent et tuent — Clément Méric. Qu’un maire ose afficher le flingue comme nouvel ami de sa police municipale, décide de débaptiser la rue du 19 mars 1962 de sa bonne ville au profit d’une rue en hommage au commandant Hélie Denoix de Saint-Marc, résistant et ancien du putsch des généraux à Alger, dit l’imaginaire viriliste et pervers qui est à l’œuvre. Mais cette violence dont nous ne voulons pas, dans laquelle nous ne nous reconnaissons pas n’entrave pas notre envie persistante de tout casser quand même. Ce désir, cette terreur, ne sont pourtant pas une folie, mais une réponse.
qui sont les violents ?
Longtemps, ceux qui étaient qualifiés de violents n’étaient pas ceux qui disposaient du monopole de la violence, appartenant à l’appareil policier ou militaire de l’État, à son appareil législatif, exécutif ou judiciaire, tous organisés pour contenir la violence, la réprimer et protéger les individus de sa brûlure. La seule violence reconnue comme telle était celle de criminels. L’appareil judiciaire d’ailleurs ne permettait pas de distinguer violence politique et violence de droit commun. On emprisonna beaucoup d’anciens militants, on jugea rapidement les nouveaux, on discrédita l’idée même d’amnistie. Face à la violence, c’était « tolérance zéro ». Ceux qui s’intéressaient à la violence politique, populaire voire révolutionnaire non pour la vilipender mais pour l’analyser et la comprendre, souhaitaient écouter les arguments des acteurs et restituer la part d’incertitude qui avait été la leur, étaient accusés de vouloir reconduire la justification du pire, les années de plomb italiennes, la bande à Baader en Allemagne, l’autonomie, l’action directe. Ces violences secrétées par nos démocraties étaient devenues taboues. Il ne fallait pas même en parler sinon pour les condamner fermement.
Mais le pire est peut-être que ça ne pète pas, qu’à chaque nouvelle agression sociale, économique, politique, on se dit que cette fois ça va venir, se lever, qu’à la violence de l’intolérable va répondre une autre violence. Et non.
Il faut, pourtant, chaque jour se souvenir que les bourreaux se déguisent en douces victimes éperdues, salissent ceux et celles qui osent leur résister, ou ceux, tout simplement, dont l’existence dérange : ce sont les Noirs qui causent l’apartheid, les Palestiniens qui construisent les murs d’Israël, les banlieusards qui créent leur ghetto. Bientôt ils nous diront que la démocratie est une violence que l’on fait à leurs dictatures innocentes, la manifestation une atteinte à leur pacifique oppression.
Ils appellent « souffrance au travail » l’exploitation, « clients » les malades, « usagers », les étudiants. Pour le reste, ce sont des « ressources humaines ». Ces mots sont des coups de poing. Puis ils nomment violence notre résistance. Ils tordent le cou au sens et appellent violence notre désespoir. Leurs masques polis grimacent de leurs rictus d’hommes de main. Ils portent nos valeurs en sautoir, ils disent que nous sommes d’accord. Leurs mensonges sont des armes de destruction.
Que dit-on de cette autre violence partout à l’œuvre, pourtant invisible, ou plutôt qu’on ne veut pas voir, parce qu’elle est organisée et silencieuse ? Violence économique, c’est-à-dire violence froide, impersonnelle, neutre, non-voulue mais assumée par ceux à qui elle profite et intériorisée par ceux à qui elle ne profite pas. Mais cette violence n’en est pas moins radicale, orchestrée, stratégique : elle n’a plus le caractère instable, spontané, et donc risqué de la violence. Pour nommer cette contradiction apparente, Naomi Klein parle de « stratégie du choc ». Elle n’est jamais explicitement jouie par ceux qui l’exercent, d’autant qu’elle prétend agir dans l’intérêt de ceux qu’elle blesse. Elle est moins brutale mais plus systématique, moins visible mais plus continue, moins spectaculaire mais plus efficace en termes de destruction et d’autodestruction. C’est une sorte de violence essentielle, c’est-à-dire une violence qui a quitté la sphère de l’accident, de l’événement imprévu, pour devenir la redondance de nos vies les plus quotidiennes.
« Mais qu’est-ce, mais qu’est-ce qu’on attend pour foutre le feu ? ». Même les plus doux d’entre nous se le demandent, et vraiment ils sont très doux.
La violence n’est plus que nommée au singulier et sans qualificatif. Elle est devenue un objet homogène qui ne peut que produire dégoût, indignation et opprobre social à l’égard de ceux qui oseraient en faire usage, produisant autour d’eux des victimes de la violence. La meilleure des victimes est réputée non-violente : les femmes ne sont pas violentes et au pire du pire, on peut leur concéder un peu d’auto-défense, mais guère plus ; les pédés, c’est bien connu, ne savent pas se battre. Quant aux autres, les violents, ils se retrouvent inéluctablement pris dans une relation d’équivalence avec les criminels et les réprouvés, qui réussit à masquer le caractère éminemment politique de la circulation de la violence dans toute société. Seule la violence sur les biens et les corps est assimilée à de la violence ; on ne parle plus de violence symbolique, loin de toute réflexion menée sur la violence même de la loi. « Le sang coule goutte à goutte dans le sillon tracé entre les grandes pierres tombales de la loi » écrivait pourtant Kafka.
violence partout
La violence est systématiquement renvoyée à l’extérieur, et de l’extérieur, on ne se lasse pas de l’étaler. Un geste dérape, immédiatement, on le renvoie à l’irrationnel, à la sauvagerie, à l’inhumanité, c’est-à-dire à un dehors absolument impensable. Ce sont les casseurs dans les manifestations, ce sont les révoltes des banlieues en 2005 : on se réjouit de dire que cette violence n’est pas l’expression d’un « projet politique », qu’elle est brutale parce qu’elle n’est pas un moyen en vue d’une fin, sans se demander de quoi cette violence est le signe — de quoi peut-elle l’être sinon d’une autre violence, sans doute bien plus grave, parce qu’on ne la voit plus.
La violence qu’on veut bien nous montrer reste aux frontières de l’empire. Elle ne nous menace pas, ne nous concerne pas. Les images affluent de corps meurtris, de villes détruites, de pays ravagés par une violence qui a depuis longtemps déserté les territoires que nous habitons. Pas si longtemps peut-être, mais elle appartient désormais au grand récit de l’histoire, forclose dans une narration qui la maintient à distance — il suffit de songer à n’importe quel cours d’histoire au lycée pour se souvenir combien la seule violence envisagée ici est celle qui se conjugue au passé. Au présent, ce sont les images apocalyptiques d’une Syrie à feu et à sang, qui a maintenant dépassé le scénario irakien brandi comme épouvantail pendant un temps par des régimes autoritaires cherchant à se maintenir en place. C’est la barbarie inconcevable de la Corée du Nord. La cruauté orientale d’un satrape, le supplice chinois réinventé. Mais cela ne nous concerne pas. La lointaine violence d’une effroyable bouffonnerie. Plus près, à nos pieds, ce sont aussi les récits épouvantables du cimetière méditerranéen où viennent mourir toujours plus nombreux les migrants par la faute — qui d’autre ? — de passeurs criminels. La violence vient cogner à nos frontières, mais elle ne nous menace toujours pas, si nous restons bien au chaud, à l’intérieur de nos lignes de démarcation. La violence croît là-bas, mais qui sait si elle ne pourra pas faire retour ? Sous le visage de mercenaires revenus de Syrie, d’apprentis jihadistes qui pourront réimporter chez nous la violence des autres, qui nous est étrangère et ne serait qu’un corps étranger expulsable par la vertu de lois rassurantes.
Pourtant, la frontière peut être à deux pas de chez nous. Les villes ou quartiers dévolus à servir de supermarchés des drogues, nombreux dans un pays où quatre millions de personnes fument du cannabis, sont comme des laboratoires expérimentaux de la dérégulation tous azimuts et de l’effondrement du rempart de l’État contre la violence. Que donne un marché à haut taux de profit sans règles ni personne pour les faire respecter, ni codification du travail, ni tribunaux de commerce susceptibles d’arbitrer les conflits, ni police en mesure d’agir ou de hiérarchiser les maux, tout le monde étant criminel aux yeux de la loi dans ce grand bazar ? De la violence. Des baffes aux petits vendeurs pris en défaut, des coups bien plus sérieux aux mauvais payeurs, un pur arbitraire policier renchérissant la tension générale, les flics décidant au gré de leurs possibilités à qui s’en prendre, et le recours aux armes quand une bande décide de réguler la concurrence et de régler un conflit de territoires — avec cette nouveauté : le 30 avril dernier, des vendeurs de chichon de Saint-Ouen ont entrepris de tirer sur la clientèle de leurs rivaux pour la dissuader d’aller acheter en face.
Que dit-on de cette autre violence qu’on ne veut pas voir, organisée et silencieuse, froide, impersonnelle, neutre, non-voulue mais assumée par ceux à qui elle profite et intériorisée par ceux à qui elle ne profite pas ? Violence économique.
Telle était l’idée qu’on se faisait de la violence des banlieues avant la focalisation quasi-générale sur les radicalisations islamistes : une bande de sauvages armés de kalachnikovs, défiant la loi de façon plus ou moins désespérée et retournant au fond sa violence contre elle-même, comme on le dit des ghettos afro-américains de longue date. Une sorte de bulle à tenir à distance, et réclamant la fermeté de l’État. Mais la responsabilité de l’État ici est gigantesque, quand il laisse fermenter dans l’illégalité un marché devenu aujourd’hui incontournable, et renforce sans cesse l’arsenal répressif pendant que d’autres pays s’engagent dans des processus de légalisation progressive. Fournir quatre millions de consommateurs, parmi lesquels 1,4 million de consommateurs réguliers, cela représente des centaines de milliers de vendeurs. En 2007, une étude estimait leur nombre en France entre 64 000 et 140 000, petits, moyens ou gros revendeurs, pour le seul cannabis. Aujourd’hui ce doit être bien davantage. Autant de personnes formées d’une façon ou d’une autre à la violence, engagées dans des rapports chaque jour plus durs avec leur environnement, accoutumées à penser en termes de réseau, de débrouille, d’argent ou de muscles. Et en face, les muscles aussi sont de sortie.
À la gare du Nord et ailleurs, on contrôle au faciès. À Calais et ailleurs, des CRS tabassent les migrants. À Paris, on ouvre une enquête. La police des polices est sur le coup. On se dit très choqué de voir ces hommes en uniforme censés représenter l’État frapper à coups de pieds dans le ventre de migrants épuisés avant de les jeter par-dessus une glissière de sécurité. À Francfort, on qualifie d’émeutiers, de casseurs, ceux qui contestent. En Grèce, on cogne aussi sur ceux qui dans la rue continuent de protester contre les violences qui leur sont quotidiennement faites. Au Canada, la police matraque des étudiants. Aux États-Unis, les forces de l’ordre tuent chaque mois des personnes de couleur qui semblent n’avoir commis comme seul crime que celui d’avoir la gueule et la couleur du bon suspect. À Baltimore, après Ferguson, la rue se lève.
À North Charleston le 4 avril 2015, un policier a dégainé son arme pour faire feu sur un homme — noir — qui tentait de fuir après un contrôle de son véhicule. Huit coups tirés dans le dos de cet homme. Cinq ont atteint la cible. Walter Scott s’est écroulé sur le sol pour mourir en quelques secondes. La violence aurait pu s’arrêter là. C’eût été suffisant et de trop. Mais le policier, conscient de sa bavure — comment n’aurait-il pas pu l’être ? —, a eu un geste d’un autre type de violence, tout aussi ultime, symbolique, étrange. Il a tenté de maquiller la scène de son propre crime en une scène d’arrestation musclée : il a disposé son taser à côté du cadavre gisant de Walter Scott pour suggérer une menace, justifier les cinq balles dans le dos. Il a ensuite passé les menottes au cadavre. Il a menotté sa victime. Tout l’attirail de la répression policière disposé sur cette scène de crime : le flingue, le taser, les menottes. Tous les degrés d’entravement, de contrainte, réunis près du corps d’un seul homme, dévoyés, perdus dans une scène qui peine à prendre sens, utilisés dans le mauvais ordre. Le geste du policier, celui de menotter le cadavre de l’homme qu’il vient d’abattre tout en voulant faire croire que celui-ci l’a attaqué avec une arme qu’il place à côté de son corps n’a pas de sens. Geste de panique ? Sur les images vidéo qui ont révélé le meurtre (c’est le chef d’accusation qui a été retenu) le policier n’a pas l’air plus inquiet. Qu’est-ce qui pourrait l’inquiéter ? Il est dans son droit. Il incarne le droit. Regardez, il lui a passé les menottes.
La violence qu’on veut bien nous montrer reste aux frontières de l’empire. Elle ne nous menace pas, ne nous concerne pas. Les images affluent de corps meurtris, de villes détruites, de pays ravagés.
Dans notre société en paix (mais probablement pas avec elle-même), cette violence fait de nous sinon des victimes du moins des témoins. Elle est partout et d’autant plus révoltante que cette violence, celle dont l’État s’accapare le monopole, devrait s’exprimer dans la plus grande mesure. La violence est peut-être l’essence de la police, il est difficile de lui en faire le procès. La police agit comme une force violente, comme un mécanisme de distribution de la violence de l’État, mais pour réguler justement la violence interne à une société, pour protéger celle-ci, et les individus qui la composent. Ce monopole, en contexte démocratique, s’exprime dans la légitimité du consensus. La force de l’État (et donc celle de la police) y devient légitime parce qu’elle est acceptée ; sa violence y est consentie comme un moindre mal. Mais sa retenue, qui s’exprime dans le droit, dans la gradation de la réponse, dans la peur qu’elle inspire aussi, ne peut être que le seul but visé. Sa seule expression est déjà le constat d’un échec. Que dire donc de son dévoiement, de sa perversion, sinon qu’ils sont l’image même d’une violence intolérable qui s’attaque aux individus, aux groupes, et qu’elle sape l’idéal démocratique en lui-même, qu’elle rompt tout consensus social, qu’elle menace tous les individus d’une société ?
Dans ce cas, il n’y a plus de distinction entre force et violence, la violence dite légitime devient brutalité, elle n’a plus rien de légitime. Le principe d’une telle violence est de rendre indistinct, « tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Si chaque société surgit à ses propres yeux en se donnant la narration de sa violence, il est temps de reprendre ce chantier, car force est de constater que la violence habite encore nos sociétés. Pour la comprendre et la retenir, il faut d’abord accepter à nouveau d’opérer des distinctions.
la violence et ses fins
Qu’on l’entende comme brutalité spontanée et gratuite sur les corps (violence prétendument originelle) ou comme oppression tantôt spectaculaire tantôt invisible des âmes comme des corps (raffinement de la cruauté), il n’est pas sûr que notre époque ait apporté de grandes nouveautés quant à la réalité de la violence. Il n’est plus très sûr en effet que les massacres de masse soient une invention des colonialismes, puis des totalitarismes. Cela fait des années en effet que les paléontologues nous rappellent combien nos ancêtres s’y connaissaient déjà en la matière : la préhistoire, notamment au néolithique mais sans doute avant aussi, fut riche en guerres (Jean Guilaine, Jean Zammit, Le sentier de la guerre : visages de la violence préhistorique, 2000). Mais nous tolérons des violences que nos ancêtres n’auraient sans doute pas acceptées — et inversement.
Si l’on veut donc saisir la nouveauté d’aujourd’hui, il faut chercher des déplacements plus ténus, et aussi plus profonds. À cet égard, un texte récent de Mathieu Potte-Bonneville sur la série la plus téléchargée au monde, Game of Thrones, s’avère peut-être particulièrement éclairant (« La Mauvaise saison », Game of thrones, série noire, Les Prairies Ordinaires, 2015). Ce succès mondial et inégalé d’une série, et d’abord d’un livre d’heroïc fantasy normalement voué au regard embrumé d’adolescents en petite forme, en dit long en effet sur l’air du temps. On pourrait retenir trois traits essentiels.
Premièrement, notre époque se caractériserait par une spécularité circulaire et inquiétante entre violences réelles et violences jouées ou filmées. Ainsi Mathieu Potte-Bonneville remarque non sans crainte et tremblement que l’on peut décrire de la même façon, d’un côté les exécutions qui ouvrent et ferment la première saison de Game of Thrones, de l’autre les exécutions de James Foley et Steve Sotloff par Daech. Formellement, le plan est le même : l’exécuté est à genoux au premier plan, tandis que son bourreau se tient debout en arrière-plan. Comme si la violence réelle était d’abord réalisée pour être vue par d’autres, tandis que la violence fictive ne serait là que pour faire jouir ces autres, c’est-à-dire nous-mêmes, d’une réalité qui, vue de face, dans les images trash du net, les épouvante. Voilà peut-être en tout cas le premier trait de notre sentiment du jour : le fameux cercle ou engrenage de la violence ne tournerait plus entre deux violences réelles, ou entre une violence physique et visible et une violence symbolique et invisible, mais entre la violence et sa représentation dans une forme de présupposition réciproque. Et avec lui, sa conséquence effectivement inquiétante : dans l’ancien cercle de la violence, tous les protagonistes s’unifient dans le jugement (« le barbare, c’est l’autre »), tandis que dans ce nouveau cercle, ils s’unifieraient plutôt dans la jouissance scopique (« on veut voir et faire voir »).
Second trait, toute l’intrigue de Games of Thrones est construite sur un canevas assez simple, celui qui dominait par exemple l’Italie renaissante de Machiavel quand ses cités se faisaient la guerre les unes aux autres pour le pouvoir central sans mesurer un danger bien plus urgent : l’arrivée des barbares de France puis d’Espagne qui allaient les emporter toutes. Sauf que dans Game of Thrones, les barbares nommés justement « les autres » ne sont pas d’autres hommes mais un danger bien plus terrible : l’arrivée de l’hiver et avec lui sa cohorte de « marcheurs blancs », monstres lovecraftiens oubliés que personne ne veut prendre au sérieux sauf à avoir le nez dessus. Or, avec un tel déplacement, on n’est plus à la Renaissance, mais bien aujourd’hui. Car l’un des dangers qui nous guette dans notre monde réel n’est pas de même nature que toutes les violences et cruautés qui peuplent notre actualité. Parce que nous serons de plus en plus nombreux dans le siècle à venir et que le modèle capitaliste est mondialisé, l’accès aux ressources de la survie multipliera les conflits. L’arrivée du réchauffement climatique ouvre le temps d’une violence imprévisible et sans précédent et la distinction entre réfugiés politiques et réfugiés climatiques sera alors vouée à la disparition (Harald Welzer, Les Guerres du climat. Pourquoi on tue au XXIe siècle ?, 2009). Ici la métaphore fantastique s’avère glaçante de réalisme comme si toutes les violences en cascade du jour n’avaient de sens qu’à servir d’écran à une violence encore à venir mais incommensurable. Comme s’il n’y avait plus que l’heroïc fantasy pour énoncer la permanence de Machiavel.
L’arrivée du réchauffement climatique ouvre le temps d’une violence imprévisible et sans précédent.
Le troisième trait vient nuancer et déplacer le précédent. Car chez Machiavel, le « bon usage de la cruauté » pose que la violence n’est justifiée qu’à être ponctuelle, radicale et définitive, c’est-à-dire uniquement quand elle permet de rendre un rapport de forces assez dissymétrique pour que cesse par la suite tout conflit. Au contraire, le trait dominant de la violence dans Game of Thrones comme dans notre monde d’aujourd’hui est l’incroyable récurrence de la violence. Elle est devenue endémique, disséminée et fondamentalement inefficace. On ne nous promet même plus un « nouvel ordre mondial » comme en 1991 lors de la Première Guerre du Golfe, on ne nous promet même plus un « plan Marshall pour les banlieues » comme en 1995, mais on nous dit que la guerre contre Daech durera trente ou quarante ans, ou on nous dit comme Manuel Valls qu’« un apartheid territorial, social, ethnique […] s’est imposé à notre pays », sous-entendant cyniquement qu’il faudra bien faire avec, tout en prétendant le contraire. Autrement dit, nous avons perdu les deux grands régulateurs de la violence : d’un côté, la promesse d’une violence retenue pour le moment opportun (la révolution ou le Grand Soir), de l’autre l’équilibre de la terreur (la violence rendue impossible pour son risque sans mesure). Comme dans Game of Thrones, nous vivons dans un déséquilibre de la terreur qui ne retient plus rien, relâche inlassablement les mêmes bouffées de violence pour la même absence de résultat, ou presque : le barrage de Sivens ne se fera pas tout à fait comme prévu initialement mais un peu quand même.
Si cette analyse n’est pas totalement inexacte, on peut s’essayer à définir succinctement à quoi devrait ressembler une actuelle pensée de gauche de la violence. Tout d’abord, commençons par nous débarrasser de deux questions répétitives. « Faut-il mourir pour ses idées ? » Marat, Jean Moulin, Rémi Fraisse ne sont pas morts pour elles : ils ont été tués. La course au sacrifice ne fera jamais une politique puisque c’est sa dénégation même : une cause collective martyrisant un individu anéantit l’horizon démocratique. « La violence permettrait-elle de parvenir mieux à ses fins ? » Là n’est pas le sujet puisqu’il ne s’agit pas de s’en accommoder mais de se soucier toujours de se battre pour en tarir les sources. Autrement dit, on cherchera plutôt à faire changer la peur de camp et par là à exhiber la retenue de notre violence, mettre en scène notre réserve de force. C’était là tout le sens des manifestations. Ce fut la puissance d’Act Up : la possibilité de faire usage d’une certaine forme de violence, la capacité à bousculer et effrayer, comme donnée à prendre en compte — et prise en compte — dans la lutte menée. Mais que le 1er mai 2015 ait rassemblé si peu de monde est un symptôme : non pas qu’il ne faille plus occuper la rue — cela se refera sans aucun doute —, mais on voit bien que ce n’est pas suffisant. Une des douloureuses leçons de la révolution égyptienne a été qu’une junte militaire a parachevé, en l’étouffant, la pichenette donnée par des millions de citoyens descendus dans les rues pour exiger enfin un État démocratique, afin de réaffirmer avec plus de force les fondements autoritaires de la dictature. La violence perçue y a été retournée à l’envoyeur, inscrivant le moment de sa nomination dans la série toujours ouverte de « révolutions » officielles, celles qui absorbent la réaction à une domination injuste des corps et des âmes et la disent inefficace, pire « terroriste ». La force n’est pas de ce côté-là mais l’a-t-elle jamais été ? Notre insistance tient aussi dans un combat du sens, dans une lutte où les violences constituent l’un des principes de déchiffrement du monde comme il va. C’est pour cela que nous nous obstinerons encore et encore à écrire, hurler, ruer dans les brancards sans trop nous soucier des déserts et sans jamais dénier les formes et les réalités de la violence. Il faut alors enfin cesser de la penser en série en droit infinie, briser son cercle nouveau et sa jouissance nouvelle, sa récurrence et son incurie. Par exemple en se recentrant sur les seules violences qui portent en elles la promesse de leur extinction, les violences de rupture et non de poursuite, les violences sans cliffhanger. Ce qui n’est le cas ni de la violence pour la maîtrise du pétrole, ni de la course à la consommation, ni des guerres au-dehors (en Irak, en Afghanistan, en Libye, au Mali…) ou au-dedans (contre les immigrés, les drogués, ou les incivilités). En bref, réapprendre à aimer comme à craindre les violences qui se dialectisent avec la paix plutôt que celles qui ne se nourrissent que de leur seule image.