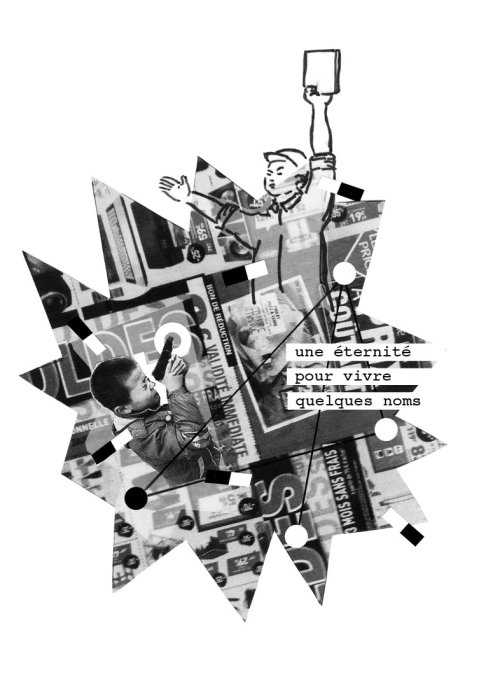Come ti chiami ?
par Zoé Carle, Vincent Casanova, Laurence Duchêne, Sophie Wahnich & Pierre Zaoui
Illustrations d’Antoine Perrot.
On en est donc là, les étendards au placard. Quel est le mot, qui aujourd’hui pourrait politiquement nous nommer ? D’être passés entre toutes les mains, les mots ont été polis jusqu’à glisser entre les doigts de qui voudrait les saisir. Les paroles fondent, soit parce qu’elles ont été trahies par l’histoire, soit parce qu’elles sont devenues de grands sacs mous impropres à dire correctement ce que l’on voudrait voir définir.
Comment t’appelles-tu ? Mon nom est Personne et il n’y a pas de quoi se réjouir : Tonino Valerii à la réalisation d’un western spaghetti qui a pour héros Terence Hill, ça ne présage guère de lendemains qui chantent. Mon nom est Rouge nous plairait plus, mais il faut admettre que le fond de l’air ne l’est pas. Il y a bien sûr la réponse de Danton lorsqu’on lui a demandé de décliner son identité lors de son procès : « Ma demeure sera bientôt dans le néant et mon nom est écrit au Panthéon de l’histoire. » « Mon nom est révolution » en somme. Dionys Mascolo, en 1955, ne disait pas le contraire : « C’est par rapport au projet révolutionnaire que la gauche laisse voir son sens, et non par rapport à la droite » [1], mais lui c’était Saint-Just qu’il aimait. Depuis, la langue est devenue comme pâteuse, l’impression de mâchonner de vieux mots, persistante. Aujourd’hui, des noms hérités sont récusés, à commencer par le couple droite/gauche qui a si longtemps défini seul la ligne d’affrontement politique. Et avec lui le mot révolution. Peut-on même évoquer République ? Les supposés fronts républicains ne résistent pas à la dissolution de la ligne de partage des eaux. Le mot peuple pourrait se prévaloir de plus de solidité. Mais La liberté guidant le peuple de Delacroix a trop servi : elle opère désormais comme une signalétique et les mots apparaissent comme de beaux joujoux retrouvés au grenier. Ils sont séduisants comme reliques, mais on ne sait pas à qui ils ont appartenu ; ils sont usés jusqu’à la corde et on voit l’ennui au travers.
On en est donc là, les étendards au placard. D’être passés entre toutes les mains, les mots ont été polis jusqu’à glisser entre les doigts de qui voudrait les saisir. Les paroles fondent, soit parce qu’elles ont été trahies par l’histoire qui leur a donné un référent inacceptable, soit parce qu’elles sont devenues de grands sacs mous impropres à dire correctement ce que l’on voudrait voir définir. La liste est longue de tous ces mots rances devenus des armes de discrédit, ces mots qui font rire quand ils ne font pas peur, derrière lesquels on ne peut plus s’abriter. Certains ont mis plus de temps que d’autres pour disparaître. Socialisme vient mourir à nos pieds après presque deux siècles mouvementés alors qu’altermondialisme approche doucement de sa date de péremption après seulement deux décennies d’existence. Ainsi la grande essoreuse s’en prend-elle même aux plus jeunes, offrant matière à mauvais esprit et calembours fainéants.
Alter- Préfixe en colère.
Anti-libéral Rien ne t’empêche, rien ne t’oblige
Autogestion Est toujours une expérience et n’a qu’un temps. La preuve : a été constitutionnalisée par Tito.
Autonomiste Selon Michèle Alliot-Marie, a une passion cachée pour les caténaires.
Cyber-trucs Super trucs online (en russe).
Décroissant Commence dès le petit-déjeuner.
Écologiste Comme ARTE, tout le monde est pour, mais pas ce soir.
Européen A fait un rêve.
Fédéraliste Vit entre Bruxelles et Strasbourg. A eu l’allure gironde en 1793.
Indignés Espagnols hesselés.
Occupy Y en n’a pas un sur cent.
Queer Nation Baiser dans l’étrange.
Révolutionnaire Cauchemar des lutionnaires.
Subalterne Antonio Gramsci en habit indien.
Zimmerwaldien La paix des alpages.
Le diagnostic pourrait donc être le suivant : les trois sources de nom traditionnelles - une personne, un lieu, une idée - se sont taries. Tout d’abord, le ralliement derrière des noms propres relève d’un temps où l’on comptait sur les grands hommes, et on préférerait ne pas : Lénine, Trotsky et Mao, vraiment non merci ! Il reste Marx évidemment et on ne compte pas s’en débarrasser. Mais sa barbe a été tellement lessivée qu’on choisira toujours de le lire plutôt que de le brandir. Il en est de même des lieux : ainsi tiers-mondiste est-il d’une autre époque. Ce qui n’exclut pas que certains aient de l’ampleur : depuis Tian’anmen, les places sont constituantes. Il suffit de penser à Tahrir, à Taksim... On aimerait bien d’ailleurs, à une autre échelle, contribuer à raviver le souvenir de Zimmerwald. En plus, on a déjà l’hymne et il date de 1936, une chouette année. Mais qui s’en souvient ? Et un nom suisse, quand même, ce n’est pas trop possible. Il nous reste donc les idées : anarchiste, anticapitaliste, communiste... Mais quand on veut être les trois à la fois ? D’autant qu’en matière d’usure des noms, on tient le tiercé ! Anarchisme : ni Dieu ni Maître — d’accord mais après ? Quant à l’anticapitalisme, il a déjà son Nouveau Parti ! Certes l’historien zapatiste Jérôme Baschet en revendique encore l’usage dans ses Adieux au capitalisme, arguant qu’il « contient en réalité, et indissociablement, l’affirmation d’un projet alternatif, lequel ne saurait être défendu sans rejeter en même temps ce qui le nie ». Mais c’est quand même sacrément compliqué de rassembler en affirmant que « la négation du monde de la négation est le point d’ancrage concret de l’impulsion émancipatrice. » Alors, pourquoi pas “communiste” ? Pour d’aucuns, il reste une hypothèse. Mais pour beaucoup, il a eu son siècle. Bref, on tourne en rond. Au fond, on sait pour quoi on serait prêt à signer tout de suite : l’idée de “commun”, défendue récemment par Christian Laval et Pierre Dardot. Commun, c’est ce qu’on vise depuis toujours : ce qui permet de penser ensemble les enjeux socio-économiques et les enjeux écologiques ; le constatif (on est de fait tous embarqués dans la même galère) et le programmatique (devenir commun est un programme fort singulier) ; le communisme, parce que la terre est un seul pays, et l’anarchisme, parce que la terre est un seul pays ; la promesse d’une communauté à venir, et l’assomption d’un commun ordinaire qui est déjà suffisant en lui-même ; le métissage et l’égalité ; l’art et la vie. La belle formule “Tout-Monde” d’Édouard Glissant pourrait exprimer assez précisément et plus poétiquement cette idée d’un commun à la fois à construire et à préserver.
La liste est longue de tous ces mots rances devenus des armes de discrédit, ces mots qui font rire quand ils ne font pas peur, derrière lesquels on ne peut plus s’abriter.
Tout le problème est que “commun” ou “Tout-Monde” ne sont pas encore des noms politiques. Ils tranchent trop peu et rassemblent trop peu. Pas en soi, pas en raison d’autres noms plus justes. Mais parce que des noms, encore des noms, on n’en veut plus. Voici l’affaire : on ne sait plus comment on s’appelle, et ce n’est pas qu’une souffrance et un manque. C’est d’abord un soulagement. L’enjeu est donc moins de trouver dans l’urgence comment on s’appelle que de s’ouvrir à la question : un nom, à quel coût ? Introduire un peu d’attente et de problème entre “Le nom est mort”/“Vive le nom”. Communisme est un nom trop sali par l’histoire, Gauche n’est plus que le slogan électoral et publicitaire de la fraction dominée de la droite qui nous gouverne depuis toujours. Minoritaire est aussi bien le slogan de tous les aristocrates flamboyants. Soit. Il nous faut autre chose. Mais ne nous pressons pas d’aboutir, entre réhabilitation de vieilles lunes et pesantes injonctions à inventer. Contentons-nous plutôt d’écouter les noms qui pleuvent de toutes parts, et parions qu’un nouveau nom finira par surgir pour nous rassembler à nouveau et nous redonner un peu de puissance en nous faisant communier dans une nouvelle et bienheureuse connerie. Rien ne presse.
des bonnes et des mauvaises choses
Chercher un nouveau nom est d’abord une bonne nouvelle. Qui pourrait ne pas se réjouir de cette capacité à mettre du jeu entre la langue, les esprits et les corps ? Comment ne pas se réjouir de voir des acteurs refuser d’être encore et encore capturés par le prêt-à-porter d’une politique qui triche elle-même son langage ?
Pour les plus humbles, les minoritaires, les excentrés, les râleurs corps et âme, les rêveurs, les végétariens, reconquérir une puissance d’agir ne peut consister en une éternelle répétition de rites établis par des conventions surannées. Il faut cesser de prendre au sérieux les mots, les noms de l’histoire, et produire un pas de côté salvateur. Échapper aux noms pour se soustraire aux manières cruelles d’être au monde politique. De fait, les noms qui surgissent sont noms d’actions et d’acteurs. Les pirates piratent, les indignés s’indignent, les occupy occupent, les engraineurs engrainent, les Protocoles Méta inventent des protocoles neufs, les amants aiment, les maîtres ignorants ignorent et se donnent des maîtres d’un jour, etc. Et tous se pensent comme manifestants qui manifestent. Rester ouvert à l’inconcevable, à la souffrance du vivant irréductible au concept, accueillir cette part de l’expérience qui toucherait le corps et pas seulement l’esprit, accueillir le sensible. Être frappé par la souffrance mais aussi par la joie, c’est là la bonne nouvelle : faire voir, faire savoir que d’une expérience de rupture, de déchirure et d’affirmation adviendra une autre manière d’être au monde, qu’il ne faut pas seulement la projeter dans le futur mais la mettre en œuvre maintenant. Alors les noms de la tribu ne doivent plus la précéder mais bien la nommer, non pas comme on donne un nom à sa poupée, mais comme on se reconnaît dans un mot modeste ajusté à des actions. Au demeurant, est-ce vraiment si neuf ? Oui et non. Car, dans les années 1990, des slogans et des groupes avaient déjà fait le choix de rompre avec le militantisme classique à visée générale au profit de luttes spécifiques et urgentes : « Act up ! »
Mais restent les mauvaises choses. Ces noms communs d’acteurs-actions permettent de nommer justement des pratiques, des terrains, des objets spécifiques dans un décalage productif : soigner le sida, sauver des vies, refuser la violence... Il s’y affirme que la vie politique peut être neuve. Mais ces noms spécifiques ne permettent pas, ou pas encore, de produire un « spectre qui hante » le monde, c’est-à-dire la puissance d’une voix qui viendrait de loin et qui s’actualiserait au présent, ce qu’on appelle une vérité historique qui donnerait du courage aux amis, le sentiment d’avoir, sinon un projet, une loi commune. Elle fonderait la communauté humaine, humanisée, humanisable que nous espérons faire venir par cette quête symbolique d’un nom… commun. Les noms spécifiques restent, pour la plupart des oreilles, des noms du seul présent de l’action. Les acteurs sont projetés dans un futur, mais leur nom ne le dit pas.
Mais plus inquiétant, ces noms d’actions, et leurs acteurs qui récusent les vieux noms du rassemblement des ancêtres, se privent du même coup de toute l’historicité de ce qu’ils ont récusé. Et finalement ils radotent sans le savoir des énoncés nauséabonds. « Ni droite, ni gauche », ce n’est pas un pas de côté actuel, mais le trouble des années 1930 posé sur la table. Sous couvert d’innovation fracassante, cela conduisait, et conduit encore, à rendre indistincts fascistes, traditionalistes et révolutionnaires. Et parce que les mots sont puissants aussi des plis historiques qui les habitent et nous habitent malgré nous, mauvais fantômes et mauvaises séductions viennent polluer ce désir de monde tout autre et font prospérer le pire : Alain Soral peut se réclamer du national-socialisme sans faire sourciller ses adeptes qui pourtant ne se pensent pas tous nazis mais “anti-système”. Un groupe de musiciens peut choisir de s’appeler Sexion d’Assaut, sans vouloir promouvoir pour autant le néo-nazisme. Avec le poids d’une histoire qui ne s’invente plus, le monde se répète dans les faux-semblants d’un langage de la capture. Sans histoire connue et critique, l’histoire se répète subrepticement et ce n’est jamais pour le meilleur.
Si nous devons inventer les mots et le nom d’une communauté politique faite de tribus armées de noms communs et d’agir-s politiques spécifiques, encore faut-il accepter de savoir de quoi notre langage reste imprégné.
Notre ambition ? Reconquérir nos vies dans l’épaisseur du temps, redonner une réserve d’expérience à nos désirs collectifs d’égalité et de justice. Nous avons encore besoin de ces noms communs. Mais qui est ce nous ? Est-ce encore celui des minorités qui rient bien — quand elles n’en pleurent pas — de ces grands noms ronflants de démocratie, d’égalité et de justice, au nom desquels on les bafoue ? Peut-être que oui. Parce qu’il n’y a jamais eu de guerres, sinon imaginaires, entre devenir minoritaire et amour des grands noms.
force et faiblesse des noms
Ne plus avoir de noms, ne plus avoir de papiers d’identité, devenir plus encore qu’anonymes : innommables. C’est en un sens le rêve tantôt avouable, tantôt inavouable, de toutes les minorités. Parce que celles-ci savent combien les noms sont d’abord des opérations de pouvoir, permettant non seulement d’égrener mots d’ordre et mensonges, mais plus encore d’élever les uns, d’abaisser les autres, d’épingler les uns et les autres, fracturant le continuum naturel des multiplicités sociales en castes, classes ou races. Les noms relèvent par définition d’une violence symbolique - elle soutire à chacun sa singularité et son autonomie — et d’une violence réelle, celle que subissent au quotidien tous ceux qui ont le malheur d’être nés sous un nom maudit — arméniens, juifs, arabes, roms, homosexuels, tutsis, indiens... ; elle peut même être double, incluant par assignation dans un ordre celui qui voudrait s’en échapper et excluant par désignation celui qui voudrait en être — double violence symbolique qui conduit à une double violence réelle : d’un côté celle des pogroms, des ratonnades, des cassages de pédés, des massacres de masses — logique de la haine —, de l’autre celle des portes fermées, du « tu n’es pas des nôtres » — logique de la négation. La nomination est une violence discrète (qui ne se voit pas d’emblée, qui sépare), et réversible, comme en témoigne le génocide rwandais : Tutsis et Hutus furent d’abord des noms inventés par les colonisateurs pour diviser et mieux régner en favorisant les premiers aux dépens des seconds, semant ainsi les graines d’un renversement génocidaire à venir. Malheur aux nommés.
Un nom, c’est donc d’abord le nom qu’un maître majoritaire (un Dieu, un père, une caste dominante, un conquérant, un parti…) a donné à un être jugé mineur et qui portera à jamais cette violence majoritaire, y compris quand le rapport se renverse et que le nom de l’opprimé devient celui de l’oppresseur. Car même quand cette nomination se fait censément au profit d’une minorité opprimée, c’est toujours aux dépens d’une autre : on parle de peuple pour ne pas parler de prolétariat ni de lutte des classes, mais on parle de « prolétariat » pour ne pas parler des sans-papiers et des minorités qui le constituent, voire il arrive qu’on parle du droit des minorités pour ne pas parler du peuple et du prolétariat. D’où le rêve de devenir innommable que le minoritaire peut ressentir, parfois contre lui-même, lui qui souhaiterait malgré tout « se faire un nom ».
Nommer, ce n’est jamais représenter, c’est créer pour, dans un même geste, se séparer d’avec certains et en rassembler d’autres.
S’en tenir à ce rêve, c’est toutefois ne comprendre que la moitié des devenirs minoritaires. Car parallèlement à cette auto-poétique de l’innommable ou de l’anonymat radical — sans nom, sans appartenance, à jamais « de la race inférieure », à jamais « pas des vôtres » —, force est de constater que les minorités résistantes se révèlent dans les faits d’extraordinaires puissances de nomination : tantôt récupérant les noms humiliants qui leur ont été attribués pour les réinvestir positivement — pédés, indigènes, niggers, connasses, etc. —, tantôt cherchant à se renommer plus justement, produisant des farandoles d’autonymes — gays, femmes, beurs, coloured people, etc. —, tantôt encore préférant démultiplier et disséminer ses noms suivant la logique fictionnalisante de la pseudonymie ou de l’hétéronymie (un hétéronyme étant, à suivre Pessoa, un pseudonyme qui a sa biographie propre) — queers, tricoteuses, rebeus, afro-américains, etc. Autrement dit se développe, parallèlement au rêve d’anonymat, un effort continuel de nomination et de re-nomination.
C’est ce qu’a parfaitement saisi Judith Butler. Elle commence Le Pouvoir des mots en rappelant l’ambiguïté de l’expression anglaise « to be called a name », qui signifie à la fois « recevoir un nom » et « être injurié ». Il y a toujours quelque chose d’insultant et d’insupportable dans le fait d’être nommé, ce pourquoi sans doute Dieu, pas le dernier des idiots, avait lancé là-dessus il y a longtemps une espèce d’interdit assez ferme. Mais toute sa tâche (à Butler, pas à Dieu) est de montrer en même temps l’inanité de toute tentative de censurer les noms imposés par l’autre dominant, notamment en raison de la capacité des minorités à opérer des « re-significations subversives », c’est-à-dire à réinscrire ses noms d’infamie dans une histoire de résistance et de création. Autrement dit, il y a moins à craindre le pouvoir des noms et des mots qu’à apprendre à en bien user politiquement en les détournant, les déformant, les laissant proliférer. Toute politique minoritaire est d’abord performative avant d’être constative : on se nomme et on voit ensuite.
Nietzsche disait que « tous les grands génies commençaient par être des nommeurs », et on peut dire que c’est effectivement là le génie des minorités, suivant une logique exactement inverse de celle de l’apophatique mystique, ou théologie négative : celle-ci niait successivement tous les noms de Dieu selon une logique essentialiste, aucun nom ne pouvant saisir justement l’essence de Dieu ; celle-là, à l’inverse, affirme tous ses noms possibles et en invente d’autres encore, suivant une logique pragmatique et situationniste (nigger en situation hostile, brother en situation amicale, black ou coloured people en situation institutionnelle, etc.). Une politique des noms, ce qu’on pourrait appeler une pragmatique de la dénomination entendue aux deux sens du terme — se dénommer et se dé-nommer — n’est certainement pas une manière de faire de beaux discours en surplomb, loin des enjeux réels d’une politique des corps ou de la vérité. Les enfants, les prétendus « sauvages », les minorités en général vivent d’abord parmi les noms, sont d’abord des nommeurs.
On doit toutefois aller plus loin. Car les minorités n’ont jamais seulement balancé entre sans nom et démultiplication des noms, mais ont tout autant cherché des noms plus universaux, qui offriraient une ligne de fuite entre les deux écueils que sont l’effort d’une pure autonymie et le rêve d’un pur anonymat : croire d’un côté que l’on est entièrement maître de son nom et donc de sa vie, et de l’autre que l’on peut s’exempter du jeu commun des dénominations en devenant un être sans particularité et sans détermination — dans les deux cas, on risque de devenir soit un tyran, soit une loque apolitique. C’est sans doute pourquoi les minorités, toutes les minorités opprimées n’ont cessé de s’investir aussi dans les noms les plus universaux : communisme, socialisme, anarchisme, républicanisme, et entre tous, celui qui était sans doute à la fois le plus universel et le plus indéterminé — la gauche. Les plus beaux noms propres sont des noms communs sous lesquels on peut à la fois n’être personne et être quelqu’un, appartenir et s’opposer, disparaître et se manifester.
De ce point de vue, il est idiot de penser que les combats prétendument post-modernes des minorités et pour les minorités ont signé la fin des grandes politiques universalistes porteuses d’une promesse commune de transformation sociale. On peut parier que ce sont les devenirs les plus minoritaires qui ont inventé les noms les plus universels et les plus gros d’une promesse commune : plus on est seul, plus on a besoin de tous, parce qu’il n’y a qu’au milieu de tous que l’on peut panser sa solitude sans la renier. Le désastre actuel de la dévalorisation des noms de l’engagement politique est d’abord un désastre pour les minorités et peut-être un désastre des minorités qui n’ont pas encore su assez inventer, se déplacer, se dé-nommer.
Donc, pour savoir comment l’on peut encore se nommer aujourd’hui, il faut répondre à trois exigences. D’abord, chercher à articuler ses noms singuliers à un nom commun : c’est sous un nom commun que les noms singuliers et proliférants peuvent se protéger de l’entre-soi ; c’est sous un nom commun qu’ils peuvent même proliférer à loisir : combien le communisme, par exemple, a-t-il produit de noms — partis, syndicats, groupes, collectifs, organisations… ? Réciproquement, cela suppose d’être attentifs à ce que ce nom commun ne s’impose pas aux singularités mais en émerge. On pourrait résumer cette seconde condition par un slogan : « Deviens ce que nous sommes ». Enfin il ne faut pas craindre, pour penser cette double articulation réciproque du commun et du singulier, de ne représenter personne. Nommer, ce n’est jamais représenter, c’est créer pour, dans un même geste, se séparer d’avec certains et en rassembler d’autres.
Pouvoir se dé-nommer aujourd’hui suppose donc une posture particulièrement malcommode et contradictoire : être attentif aux pratiques collectives réelles et opérer par coups de force ; à la fois être plusieurs et seul ; ne viser qu’au commun mais dans la seule pensée de son être minoritaire ; être capable de recycler un nom du passé et en inventer un nouveau. Bref, être poète et sociologue, historien et économiste, quelque chose de monstrueux. Mais tous les noms nouveaux sont des noms de monstres : des spectres, des Golems.
du vrai nom
Pour finir, arrêtons de tourner autour du pot. Il faut bien apporter notre pierre, comme on peut : pouvoir des mots, pouvoir des clodos. Alors voilà, le nom que l’on voudrait dirait ceci. Il dirait et le commun et la séparation, la force de ceux qui savent où ils vont et la faiblesse des perdus qui ont besoin de savoir encore comment ils s’appellent quand ils ne savent plus où ils vont. Il dirait toute la justice et toute l’injustice assumée, affirmée, qu’il y a à se nommer, c’est-à-dire aussi bien à nommer l’autre, les autres, toutes choses, puisqu’aucun nom ne signifie rien en-dehors des autres noms. Il ne dirait donc ni la vérité de ce qu’on est (manquerait plus que ça), ni la vérité de notre devenir (il ne faut pas trop rêver), mais quelque chose entre les deux, une sorte de constat performatif ou de fiction vraie, l’élan du réel, de l’impossible, vers un peu de mieux, un peu de possible. Ce serait un nom qu’on pourrait crier dans la rue et murmurer au creux du lit. Un nom qui nous gonflerait de fierté tout en nous rappelant combien nous ne sommes rien, sinon comme être collectif rassemblé sous ce nom. Un nom qui convoquerait des colloques savants et s’entendrait dans le quotidien des cafés. Un nom en somme assez bien, assez nécessaire, quelque chose en tout cas d’un peu mieux que coco, nanard ou lapin.
Amis poètes, au boulot s’il vous plaît. ■
Notes
[1] Dionys Mascolo, Sur le sens et l’usage du mot « gauche » (1955), réédité en 2011 par les Nouvelles Éditions Lignes.